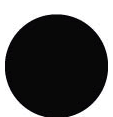| |
La main, la musique et l’image
Un chant haut perché, un son dans la tête, dans la gorge, dans le ventre.
Une guitare qui caresse une nostalgie. Un saxophone qui crie au loin.
Je n’entends pas les rythmes de la batterie. Je n’entends pas une chanson.
J’entends une couleur, un rouge, un vert, un jaune, …,
et au lointain le drapeau cubain, le drapeau de tous les drapeaux d’Afrique indépendante.
Boulimiques, les bouches avalent les micros et déhanchent le retour civilisé du tam-tam en Marimba, Mambo, Tcha-tcha , Danzon ou… Un pincement de cora, une valse réinventée par le désir, un quadrille culbuté par le désordre d’un bonheur, là, toujours là.
Il a fallu les peintures de Vincent Michéa pour que j’entende enfin la peinture. Et pourtant la peinture depuis un siècle court après la musique dans l’impossible captage spirituel des rythmes et des mélodies a-mélodiques :
Je n’entendais rien, je regardais les abstractions fascinantes sans jamais ne rien n’entendre. Même
l’initiateur Kandisky
Avec Vincent Michéa, il n’y a pas d’abstraction, pire il y a reproduction semble-t-il exacte d’un graphisme de disque, de pochette de disque . Mais il y a ce que je n’avais jamais entendu en regardant une image :
Plus que le son, l’univers du son qui mélange mélodies, brouhaha, corps, parfums mêlés de transpiration.
On parlera d’évocation, de nostalgie. Peut-être mais certainement pas que de cela. Une pochette
De disque n’a jamais été une partition que l’on lit, des notes transformées immédiatement en musique dans les oreilles.
La peinture transforme tout. Comme si nous entrions dans un autre type de sillon de disque. La peinture invente une gravure d’images à sons. On ne se pose même pas la question. On regarde fasciné, les oreilles ouvertes et les sons arrivent sans autres mélodies précise. Je cherche à reprendre mes esprits en me disant que je suis pire qu’un cerveau mou, avec mon réflexe pavlovien. Rien n’y fait, l’image a envahi mes oreilles.
J’ai besoin de partir sans partir, de rêver éveillé, d’embrasser une peau que j’aime à la folie sans folie. Je ne veux plus penser pour penser : réfléchir sans fin au rôle de l’image multipliée jusqu’à nous rendre aveugle, de l’artiste qui se prend pour un Artiste puisqu’on le lui dit, des métiers, tous les métiers, qui croient savoir…Sauf quand la main, la bouche reprennent le dessus, sans comprendre, sans stratégie, sans inquiétude du regard de l’autre. Rien d’autre que le travail bien fait, la satisfaction du travail bien fait, répétitif, qui pourrait n’être que laborieux si la fabrication de l’image n’était pas le rituel amoureux de la musique.
Ce n’est pas ce qui est peint qui est émouvant, c’est la main qui peint dans un geste si humble qu’il laisse mon regard exister. Et l’imaginaire de l’image m’envahir tout entier jusqu’à cette main qui ne sait pas pourquoi mais sait quoi, qui remonte jusqu’au visage et se met à voir, une main qui caresse les oreilles, les cheveux, le crane, et glisse des seins au ventre, au sexe, aux cuisses, aux pieds.
C’est la main qui reconstitue le corps et lui donne son esprit. C’est la main qui se met à chanter et c’est la main que j’entends comme si la peinture reprenait vie par là ou elle c’etait exclue du champ contemporain :
la représentation du réel.
La peinture revient évidente par son manque total de raison d’exister à l’époque du déferlement de l’image photo et vidéo. Et c’est probablement là que l’on ne l’y attendait plus : L’ hyperéalisme, les nouveaux figuratifs, sont bien loin, depuis si longtemps. Revoir la peinture me fascine et me décontenance totalement, comme si tout ce à quoi je croyais tombait, moi qui aime et crois au trait expressif, à la charge d’un pinceau, au geste, et à l’impossible représentation du réel. Je me retrouve à écrire un texte sur ce qu’à priori, je ne peux pas aimer, ce que je refuse depuis que je regarde les images en flâneur, en dilettante de la lecture critique. Jean Loup Pivin (La Revue Noire), Paris, Mars 2005 |
|